Infertilité
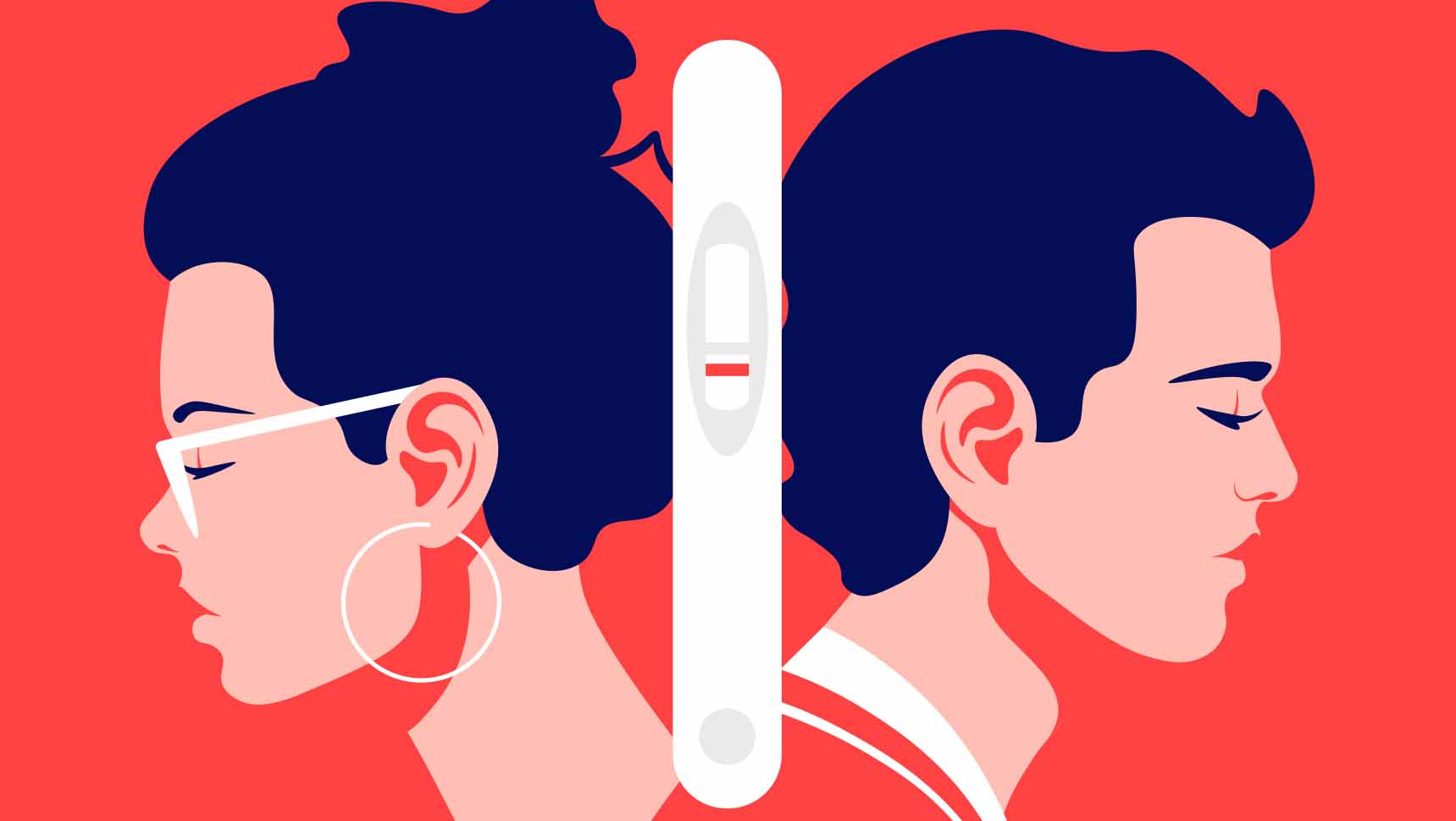
L’on parle d’infertilité lorsqu’une grossesse n’est pas obtenue après 12 mois de rapports sexuels complets, réguliers et sans contraception. Dans le système reproducteur féminin, l’infertilité peut être due à toute une série d’anomalies des ovaires, de l’utérus, des trompes de Fallope ou encore du système endocrinien. L’infertilité féminine fait l’objet d’une grande variété de traitements, selon ses causes.
Qu'est-ce que l'infertilité féminine ?
L’infertilité est l’incapacité pour un couple hétérosexuel de concevoir un enfant après 12 de rapports sexuels réguliers, sans contraception.
Dans environ trois quarts des cas, l’infertilité est d’origine féminine, masculine ou les deux à la fois.
Dans 10% des cas, elle reste inexpliquée. L’infertilité peut être primaire ou secondaire :
- on parle d’infertilité primaire lorsqu’une personne n’a jamais mené une grossesse à bien ;
- on parle d’infertilité secondaire quand au moins une grossesse antérieure a abouti.
Causes de l'infertilité féminine
Causes hormonales
Les troubles de l’ovulation sont l’une des causes les plus courantes d’infertilité féminine.
Ils peuvent être dus à :
- un syndrome des ovaires polykystiques (SOPK) : environ 10 % des femmes en souffrent.
Ce syndrome se caractérise par un dérèglement hormonal (LH et FSH), associé à un excès de production de testostérone par les ovaires.
Cela entraine une hyperpilosité et une absence d’ovulation chez la moitié des femmes concernées.
Le SOPK est la première cause d’infertilité chez la femme jeune. - une insuffisance ovarienne : il s’agit de la première cause d’infertilité après l’âge de 35 ans.
Elle ne peut pas être corrigée par une assistance médicale à la procréation (PMA), à moins de faire appel à un don d’ovocytes ; - une insuffisance ovarienne prématurée (IOP) : il s’agit d’une perte folliculaire anormalement importante,
associée à l’absence de cycle menstruel, avec une ménopause précoce survenant avant l’âge de 40 ans ; - l’hyperprolactinémie : elle se caractérise par une sécrétion excessive de la prolactine,
l’hormone de lactation issue de l’hypophyse. Cette hormone est capable de freiner l’activité de l’hypothalamus et de générer des troubles de l’ovulation
pouvant aller jusqu’à une aménorrhée complète ; - l’insuffisance lutéale : on parle d’insuffisance lutéale lorsque le follicule ovarien,
qui devient le corps jaune, ne produit pas assez de progestérone. De ce fait, l’épaississement de la paroi interne de l’utérus n’est pas correct et donc,
cela empêche l’implantation de l’embryon après fécondation ; - une hypothyroïdie ou une hyperthyroïdie : ces troubles de la thyroïde peuvent avoir un impact sur la fertilité,
en engendrant une anomalie ovulatoire et une perturbation du cycle.
Altération des trompes de Fallope
Les trompes de Fallope peuvent être obstruées ou endommagées, et ainsi empêcher les spermatozoïdes de rencontrer l’ovule :
l’on parle dans ces cas d’anomalies tubaires.
Les causes des altérations ou obstructions sont multiples :
- les infections sexuellement transmissibles : elles sont responsables des obstructions dans la majorité des cas.
La chlamydia et les gonocoques sont les germes les plus fréquemment en cause de salpingites ; - l’endométriose : cette maladie touche près de 10 % des femmes. Elle est due à l’implantation de fragments de tissus identiques à l’endomètre
dans la cavité péritonéale et, parfois, sur les ovaires. Même si les femmes qui en sont atteintes peuvent avoir des difficultés à concevoir,
l’endométriose n’est pas obligatoirement synonyme d’infertilité.
Les anomalies tubaires peuvent également être dues à :
- des complications lors d’un avortement à risque ;
- une septicémie du post-partum ;
- une chirurgie abdominale ou pelvienne.
à la suite d’un accident ou à d’une maladie.
Problèmes utérins et cervicaux
Les anomalies utérines peuvent empêcher l’implantation de l’embryon ou mener à des fausses couches.
Ces anomalies peuvent être des :
- fibromes utérins : tumeurs bénignes dans la paroi de l’utérus ;
- polypes utérins : excroissances bénignes dans la cavité utérine ;
- anomalies congénitales : défauts présents à la naissance, tels qu’un utérus bicorne.
Les problèmes cervicaux (liés au col de l’utérus) responsables de l’infertilité peuvent quant à eux être dus à :
- du mucus cervical : le mucus est trop épais pour permettre le passage des spermatozoïdes ;
- une sténose cervicale : il s’agit du rétrécissement du col de l’utérus.
Mode de vie et environnement
Plusieurs facteurs liés au mode de vie et à l’environnement peuvent affecter la fertilité féminine :
- l’âge : la fertilité diminue naturellement avec l’âge, particulièrement après 35 ans ;
- le poids : l’obésité ou l’insuffisance pondérale peuvent affecter l’ovulation ;
- le stress : le stress chronique peut perturber l’équilibre hormonal.
- l’exposition à des toxines : produits chimiques industriels, pesticides et autres substances toxiques ;
- le tabagisme ;
- la consommation excessive d’alcool et de drogues.
Anomalies génétiques
Le Syndrome de Turner est une anomalie chromosomique (perte d’une partie d’un chromosome X) qui entraîne une atrophie et un mauvais fonctionnement de l’ovaire,
ce qui peut engendrer une infertilité.
Diagnostic de l'infertilité féminine
Le diagnostic de l’infertilité féminine repose d’abord sur un examen clinique de la patiente.
Le médecin s’assure que le cycle menstruel est normal, et que les organes reproducteurs fonctionnent correctement.
Ensuite, des tests sont généralement effectués. Il s’agit notamment :
- tests d’ovulation : pour vérifier la bonne quantité d’hormones dans le sang de la patiente et vérifier qu’elle ovule bien ;
- test de Hühnër : à réaliser quelques heures après un rapport sexuel, pour contrôler la qualité de la glaire cervicale produite par l’utérus.
Cette substance permet aux spermatozoïdes de mieux se déplacer et d’atteindre l’utérus ; - hystérosalpingographie : cet examen radiographique permet de visualiser l’utérus et les trompes de Fallope pour détecter d’éventuelles anomalies ;
- échographie pelvienne : cet examen utilise des ultrasons pour visualiser l’utérus et détecter des anomalies de l’utérus, des trompes ou des ovaires ;
- laparoscopie : cet examen peut être demandé si la suspicion d’infertilité s’accompagne d’une suspicion d’endométriose ;
- spermogramme du partenaire : ce test analyse le sperme du partenaire pour évaluer la qualité et la quantité des spermatozoïdes.
Des tests génétiques peuvent aussi se révéler nécessaires afin de dépister une origine génétique à l’infertilité.
Traitements de l'infertilité féminine
Le traitement de l’infertilité féminine dépend de la cause sous-jacente.
Dans certains cas, un simple changement de mode de vie, comme perdre du poids ou arrêter de fumer, peut suffire à améliorer la fertilité. D’autres cas peuvent nécessiter :
- traitements médicamenteux : pour stimuler l’ovulation ou pour corriger les déséquilibres hormonaux ;
- chirurgie : correction des anomalies utérines, traitement de l’endométriose, réparation des trompes de Fallope ;
- techniques de procréation assistée : insémination intra-utérine (IIU), fécondation in vitro (FIV),
injection intracytoplasmique de spermatozoïdes (ICSI).
Technologies d'assistance à la procréation féminine
- insémination artificielle (IA) : elle consiste à placer des spermatozoïdes lavés dans l’utérus
au moment de l’ovulation pour augmenter les chances de fécondation.
L’insémination artificielle peut se faire soit avec le sperme du conjoint (IAC), soit avec le sperme d’un donneur (IAD) ; - fécondation in vitro (FIV) : technique plus complexe qui consiste à prélever des ovules matures,
à les féconder par des spermatozoïdes en laboratoire, puis à transférer les embryons qui en résultent dans l’utérus de la femme ; - injection intracytoplasmique de spermatozoïde (ICSI) : technique utilisée en FIV,
qui consiste à injecter un seul spermatozoïde directement dans un ovule mature pour favoriser la fécondation ; - don d’ovocytes : si une femme ne produit pas d’ovules de qualité suffisante,
elle peut envisager un don d’ovocytes. Dans ce cas, les ovules d’une donneuse anonyme sont fécondés par les spermatozoïdes du partenaire masculin et les embryons qui en résultent sont transférés dans l’utérus de la receveuse.
Prévention de l'infertilité féminine
- Maintenir un poids santé grâce à une alimentation équilibrée et à l’exercice régulier ;
- éviter les comportements à risque tels que le tabagisme, l’usage de drogues et la consommation excessive d’alcool ;
- se protéger contre les infections sexuellement transmissibles (utilisation de préservatifs, dépistage régulier) ;
- gérer le stress et consulter régulièrement un médecin pour des bilans de santé.
Infertilité Masculine
L’infertilité masculine désigne l’incapacité d’un homme sexuellement mature à féconder. L’infertilité masculine peut être responsable, en tout ou en partie, de 40 % de l’infertilité chez les couples qui essaient d’avoir des enfants. Elle touche environ 7 % de tous les hommes. L’infertilité masculine est généralement due à des déficiences dans le sperme , et la qualité du sperme est utilisée comme mesure de substitution de la fécondité masculine. Plus récemment, des analyses avancées du sperme qui examinent les composants intracellulaires du sperme sont en cours de développement.



